
Si, en 40 ans, la France a atteint et même dépassé son objectif de 80 % de bacheliers par génération ouvrant une massification de l’enseignement supérieur, elle n’a pas su accompagner cette ambition par des moyens à la hauteur des enjeux. Le CESE a travaillé ce sujet afin de contribuer à rebâtir un service public de l’enseignement supérieur en capacité de préparer et anticiper un avenir pour notre jeunesse et notre société. Kenza Occansey, rapporteur de cet avis, répond à nos questions.
Dans une période où il est plus question de faire des économies que des dépenses, qu’est-ce qui justifie de parler dans cet avis d’augmenter le financement de l’enseignement supérieur ?
C’est justement dans les périodes de crise et de fragilité qu’il faut investir dans ce qui constituera un socle pour la société de demain. Et l’enseignement supérieur a une place stratégique à ce niveau.
L’enseignement supérieur d’ailleurs n’est pas une dépense mais un investissement : chaque euro dépensé génère plus qu’un euro pour les pouvoirs publics, en formant des personnes mieux insérées sur le marché du travail, plus compétentes, moins exposées au chômage par exemple. Mais ses bénéfices dépassent la seule dimension économique : il permet aussi de préparer la société aux grandes transitions, en particulier la transition écologique, en formant celles et ceux qui inventeront les solutions de demain. C’est un investissement rentable monétairement, socialement et démocratiquement, qui produit des effets positifs pour l’individu comme pour la collectivité, pour le secteur privé comme pour le secteur public. Ne pas investir maintenant coûterait bien plus cher à l’avenir.
Vous parlez dans cet avis de la nécessité de sortir d’une logique de marché des formations… Quels sont les enjeux dans les rapports structurels, mais aussi en termes de formation, entre l’enseignement supérieur public et privé ?
L’essor du privé est d’abord le symptôme d’un désengagement du public : il représente aujourd’hui plus d’un quart des étudiants, contre 13 % au début des années 2000, avec une forte progression du secteur lucratif souvent insuffisamment contrôlé. Il ne s’agit pas d’opposer public et privé : le privé a une place, mais l’enseignement supérieur reste un service public stratégique. Cela signifie que tous les acteurs doivent se plier à des règles communes de qualité de formation, de transparence et d’accessibilité. Nous devons éviter toute logique de prédation dans un secteur essentiel pour l’avenir du pays. Cela passe par un renforcement du service public, une clarification des missions de chacun, une régulation ferme du privé lucratif et un accompagnement du privé non lucratif, afin que la complémentarité se fasse dans l’intérêt général et non selon une logique de marché.
Comment envisagez-vous le rôle des différents acteurs (Territoires, établissements, personnels) pour redynamiser le secteur public de l’enseignement supérieur ?
Tout commence par une clarification des missions prioritaires de l’enseignement supérieur. Une fois ce cadre posé, il faut donner aux acteurs concernés – personnels, établissements, collectivités territoriales – les moyens d’accompagner l’élan décidé collectivement par la société. Les campus doivent devenir de véritables laboratoires de société : moteurs de la transition écologique, lieux d’expérimentation de nouvelles formes de vie étudiante et de coopération territoriale, espaces d’intelligence collective au service de l’avenir. Cela suppose une reconnaissance accrue des personnels, une amélioration de leurs conditions de travail et une valorisation de leur rôle central. Cela implique aussi de renforcer les partenariats entre établissements et collectivités, pour inscrire pleinement l’enseignement supérieur dans le développement des territoires. Redynamiser le public, ce n’est pas forcément recentraliser : c’est permettre à chacun d’agir dans un cadre stratégique commun.
Pour en savoir plus sur ce rapport, cliquez ici
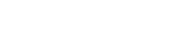 L’actualité économique, sociale et environnementale
L’actualité économique, sociale et environnementale 


